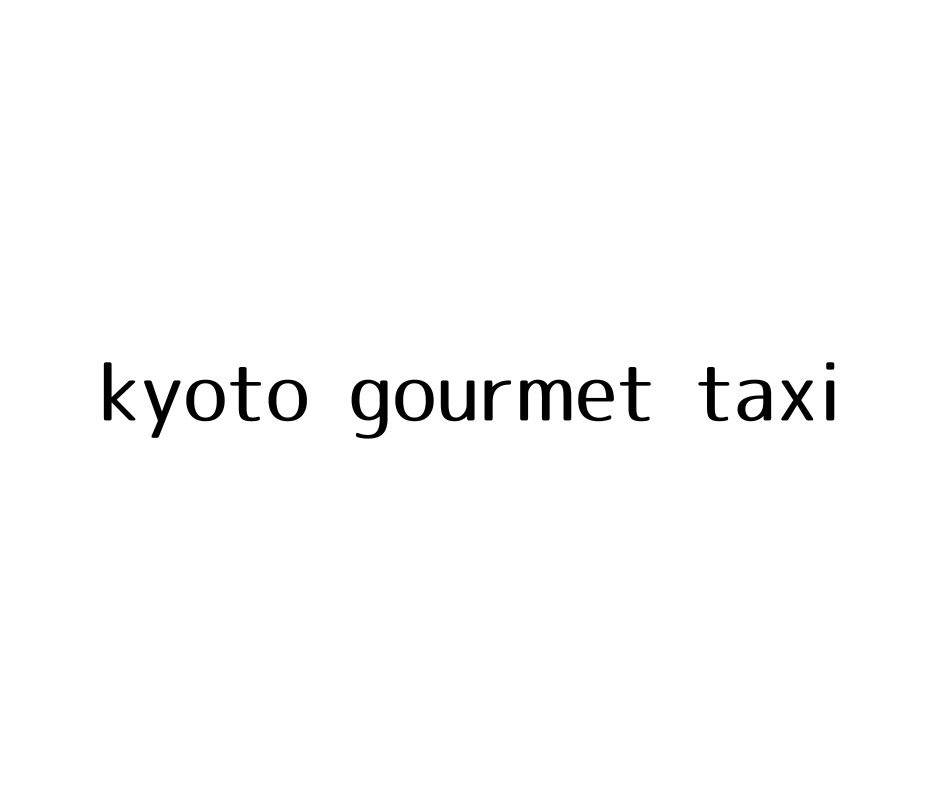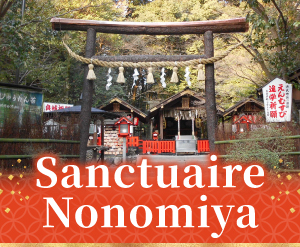Des sentiers parallèles, près du Pavillon d'Argent de Kyoto, longent un étroit canal qui coule à proximité de Nanzenji, un temple bouddhiste de la fin du XIIIe siècle. Au nord se trouve le mont Hiei, à l'ouest l'université de Kyoto et la rivière Kamo, et à l'est Higashiyama, littéralement les « montagnes de l'Est ». Vous êtes sur le Chemin des Philosophes — Tetsugaku no Michi — une courte promenade vers un passé tumultueux et glorieux.

Le chemin du philosophe à Kyoto, au Japon, pendant la saison des cerisiers en fleurs
À la fin du XVe siècle, lorsque le shogun Yoshimasa se retira du pouvoir pour construire ce qui allait devenir un monument à l'esthétique japonaise, il choisit un endroit paisible aux abords de Kyoto, au pied du mont Daimonji, dans le Higashiyama. Il le baptisa Ginkakuji – le temple du Pavillon d'Argent –, une version plus modeste du lumineux Kinkakuji, ou Pavillon d'Or, de son grand-père, situé à quelques kilomètres à l'ouest. Le « paysage emprunté » du Higashiyama boisé offrait sans aucun doute un cadre tout aussi contemplatif au Nanzenji, souvent détruit et reconstruit.
Peu de temps après sa nomination à la faculté de philosophie de l'Université impériale de Kyoto (aujourd'hui l'Université de Kyoto), Nishida Kitaro « découvrit », écrit sa biographe Michiko Yusa dans Zen et philosophie, « qu'une promenade quotidienne l'aidait à changer d'humeur. Il adopta donc une routine quotidienne, se rendant non seulement au Pavillon d'Argent (Ginkaku-ji), mais aussi aux quartiers de Honen'in et de Nanzenji, où le paysage est exquis. » 1 C'était en 1910, et jusqu'à sa retraite en 1928, Nishida parcourut littéralement le sentier qui allait devenir Tetsugaku no Michi. Les guides et cartes actuels le décrivent généralement comme « La Promenade du Philosophe » ou « Le Chemin de la Philosophie », chacun riche en suggestions.
Car Nishida n'était pas seulement un philosophe ; en un sens, il était le philosophe. Figure de proue de ce qu'on a appelé l'École de Kyoto, Nishida est, de l'avis général, le plus grand philosophe japonais. Intellectuel public, il fut finalement, avec difficulté, entraîné dans la politique nationaliste du Japon en guerre. Un groupe d'étudiants japonais en Allemagne dans les années 20 et 30 avait attiré l'attention de philosophes de premier plan comme Edmund Husserl et Martin Heidegger sur son œuvre. Mais la teinte nationaliste, la langue et les concepts notoirement difficiles de Nishida, ainsi que la lenteur avec laquelle il traduisit son œuvre prolifique dans les langues européennes contribuèrent à le faire tarder à être reconnu au-delà du Japon comme un philosophe de premier plan.
Il convient également de dire que Nishida a suivi « la voie de la philosophie », car il a assimilé la philosophie occidentale, des Grecs anciens à ses contemporains européens. Ne se contentant pas d'interpréter la philosophie occidentale à ses étudiants et collègues, il l'a véritablement intégrée à la philosophie japonaise, issue, dans son cas, du terreau fertile des classiques chinois et japonais et de la pratique du zen. Nishida était un homme de la Renaissance, dévorant les biographies des grands penseurs qui l'avaient précédé et toujours intéressé par les théories scientifiques les plus récentes. Il trouvait du réconfort dans la calligraphie et l'écriture du waka, une forme poétique traditionnelle.
Nishitani Keiji, lui-même l'un des plus grands penseurs de l'école de Kyoto, a rendu hommage à Nishida dans un livre hommage à son professeur (Nishida, 1991) :
À notre époque, il apparaissait toujours en classe vêtu d'un kimono et de chaussures basses. N'ayant jamais vu une telle combinaison auparavant, nous trouvions cela étrange. (Plus tard, il chaussa des sandales de paille.) La première chose qui frappait chez lui était son front incomparablement haut. Je n'avais jamais vu un front aussi haut chez quelqu'un d'autre. On aurait dit qu'il ne faisait pas partie de son visage, mais qu'il avait une existence indépendante.
L'image est suggestive, mais ne résiste pas entièrement à l'examen des photographies contemporaines. Plus révélateur est son style de cours. Une posture « centrée » et penchée en avant, écrit Nishitani, donnait l'impression que c'était simplement la façon dont son corps se maintenait et se tenait en équilibre autour de son centre de gravité. Le voir marcher confirmait cette impression. Chaque partie de son corps bougeait avec vivacité, ses épaules se détendant pour que ses bras puissent se balancer librement au rythme de sa démarche brusque. Tout son corps semblait fonctionner en parfaite harmonie, et jamais autant que lorsqu'il arpentait l'estrade pendant ses cours. Cette vigueur physique semblait conférer une vitalité particulière à ses paroles.
Pour ses conférences spéciales, auxquelles Nishida arrivait généralement trente minutes en retard :
Debout sur l'estrade, il marmonna un moment à voix basse, puis se mit à arpenter les lieux. À mesure que le sujet l'enthousiasmait, il oubliait complètement son allure, ses gestes et l'expression de son visage. Les mots jaillissaient de lui comme chargés d'électricité, se transformant parfois en éclairs… J'avais l'impression d'écouter un grand morceau de musique ; parfois, je me sentais frappée par quelque chose au plus profond de moi-même, parfois, je m'envolais comme sur les ailes d'un oiseau. Ses conférences touchaient profondément l'âme.
L'intensité des efforts intellectuels de Nishida, compliquée par des désirs contradictoires de se faire un nom et d'honorer l'idéal bouddhiste de « lâcher prise sur les choses de ce monde », a peut-être contribué à un certain éloignement de sa famille. Quatre de ses huit enfants et sa première épouse, après une longue maladie, l'ont précédé dans la mort. Les promenades rapides de Nishida parmi les pins et les temples anciens lui ont certainement apporté un certain réconfort.
Depuis la Grèce antique, les philosophes ont trouvé la marche particulièrement propice à la réflexion productive. Dans le célèbre et fantaisiste tableau de Raphaël, « L'École d'Athènes », Platon et Aristote sont presque seuls représentés « à la marche ». Les disciples d'Aristote étaient connus sous le nom de péripatéticiens – littéralement « ceux qui marchent » –, probablement en référence à la pratique d'Aristote consistant à marcher avec ses étudiants lorsqu'ils philosophaient, ou à la promenade publique du Lycée, leur itinéraire habituel. Emmanuel Kant était célèbre pour la régularité horlogère de ses promenades à Königsberg à la fin du XVIIIe siècle. Jean-Jacques Rousseau et Henry David Thoreau ont consacré des volumes entiers à l'art de la marche.
Comme Kant, Nishida semblait préférer, et exiger, les promenades solitaires. « Nishida marchait toujours seul », m'expliqua le professeur Yusa, sauf lorsqu'il sortait spécialement se promener avec ses amis ou collègues. Le but premier de ces promenades : une certaine agitation intérieure, caractéristique de Nishida, combinée au besoin de se dégourdir les jambes, de prendre l'air et de se détendre. Il semble également avoir beaucoup réfléchi en se promenant.
Selon le professeur Yusa, les promenades de Nishida duraient deux heures ou plus. Dénonçant toute connaissance d'itinéraire spécifique ou typique, elle cite dans un courriel le Tetsugaku no Michi, censé être inspiré de celui de Nishida. Je pense qu'il appréciait cet itinéraire car il était calme, le chemin traversait une zone boisée et, à l'époque, il devait y avoir très peu de circulation. De plus, il y avait des temples célèbres le long du chemin, comme Honen'in, Nanzen-ji et Ginkaku-ji. Je pense que… ce chemin était pour Nishida à la fois familier et intéressant.
Mais peut-être pas si intéressant. Selon Ken Mogi, des Sony Computer Science Laboratories de Tokyo, Nishida s'est peut-être « ennuyé » de la créativité en raison de la familiarité de ses promenades quasi quotidiennes. Mogi, lui-même un fervent adepte de la Promenade Philosophale, suggère que la Promenade Philosophale de chacun « est le chemin qu'il emprunte au quotidien. Nul besoin d'aller jusqu'à Kyoto pour trouver l'inspiration. »
La marche et d'autres formes d'exercice stimulent le cerveau, ce qui est sans aucun doute un atout pour la pensée créative, à condition que l'activité elle-même ne nécessite pas une concentration excessive. Les promenades de Nishida étaient « bien sûr bonnes pour sa santé », explique le professeur Nishitani, mais elles étaient aussi clairement conçues comme une sorte de retraite au milieu de l'activité, un moment d'exercice méditatif ou kinshin. Sans aucun doute, ces promenades lui ont-elles aussi donné de nouvelles idées, le genre d'idées que le corps saisit mieux que le cerveau.
Le professeur Nishitani rapporte un exemple précoce d'une promenade de Nishida stimulant une idée profonde, qui deviendrait le point de départ de toute l'œuvre ultérieure de Nishida : une expérience pure et directe agissant vers l'extérieur.
Je me souviens que Nishida m'a raconté un jour comment, lors d'une promenade à Kanazawa, une abeille ou un taon bourdonna près de son oreille, et ce bruit éveilla soudain en lui la conscience du point de vue de l'expérience pure. C'est le moment de l'écoute directe, avant même d'avoir le temps de faire la distinction entre soi et quoi que ce soit.
Les panoramas – et leurs significations profondes – le long de l'Allée des Philosophes et des temples avoisinants suscitent encore aujourd'hui émerveillement et admiration. Nishida se sentait sans doute familier en apercevant l'étage supérieur du Pavillon d'Argent au-dessus des arbres ou en se promenant parmi les tombes du Honen-in. Même au bord de l'étroit canal qui borde Tetsugaku no Michi, le philosophe pouvait, à une certaine heure de la journée ou à une certaine saison, se sentir chez lui, malgré les boutiques et les maisons qui ont poussé comme des champignons. Qu'il ait choisi de se consacrer à ses réflexions les plus profondes ici est une question de spéculation, mais les propres mots de Nishida, gravés (en japonais) sur une pierre basse le long de l'Allée, offrent peut-être un indice :
Laissez les autres faire ce qu'ils veulent,
Je suis qui je suis.
En tout cas, je vais suivre le chemin
Que je fais moi-même.

1. Michiko Yusa, dans Zen et philosophie (University of Hawaii Press, 2002, pp. 121-22)
2. Nishida Kitarō. Par Nishitani Keiji. Trans. Par Yamamoto Seisaku et James W. Heisig. Berkeley : Université. de Californie Press, 1991
| Instructions | Shishigatani Honeninnishimachi, Kyoto-Shi Sakyo-Ku, Kyoto-Fu, 606-8427, Japon |
|---|